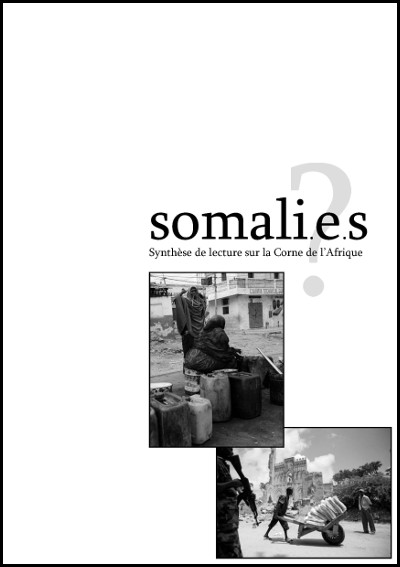Orthographié selon l’usage colonial français, ce chapitre est une réflexion critique sur la démarche d’écrire un livre sur une région que l’on ne « connaît » qu’à travers des lectures et des images : Ce que je me suis néanmoins permis de faire et que vous tenez entre les mains ! Comme je le précise dans ma courte introduction, cet abrégé n’est qu’un résumé de ce qui m’a été accessible sur la Somalie, par le prisme de leurs auteurs, un peu de ce qu’il nous est donné à voir sur le sujet lorsqu’on en est aussi éloigné que je le suis. Il aurait pu s’intituler « La Somalie vue de France » ou, plus laconiquement, « La Somalie vue de loin » !
Mon intérêt pour la Somalie n’est pas nouveau, ce qui l’est, c’est la somme d’informations que j’ai emmagasiné durant l’année qui vient de s’écouler. Généralement, j’aime faire part de mes lectures et des réflexions qui en découlent lors de discussions avec quelques proches. Mais avec toutes ces informations, je peinais de plus en plus à partager, sans noyer mes interlocuteurs dans des bouts de lectures ou des anecdotes qu’il était difficile pour eux de lier ensemble. Lors d’une discussion, une amie m’a suggéré d’écrire un texte pour qu’elle puisse enfin y voir plus clair dans ce fatras de mots ! Cela m’a paru plutôt incongru et ma première réaction fut de repousser cette idée. Pour moi, il y a une grande différence entre parler d’un sujet entre proches et le formaliser sur papier, d’autant plus lorsqu’il s’agit de connaissances livresques. Cette idée soulève de nombreuses questions qui, pour la plupart, me semblent insolubles. Finalement, après des discussions et des mois de réflexions, je me suis lancé dans l’écriture en me fixant l’objectif de rédiger le présent chapitre. Cela pour deux raisons principales. La première est qu’un livre, et ce qu’il contient, échappent à l’auteur, à tel point que le sens que celui-ci donne au texte peut être interprété, détourné ou obscurci, voire absent. Je voulais pour cela un texte indissociable de l’ensemble du bouquin. La seconde raison, qui en découle, est que je ne veux pas tromper celles et ceux qui liront cet abrégé en omettant de leur en rappeler les limites. Pour une meilleure compréhension, le contenu de ce livre est un ensemble indissociable.
Pour autant, ce chapitre ne prétend pas sortir des dilemmes mais propose de poser quelques-unes des questions qui en découlent par le biais d’exemples concernant la Somalie, puisés dans la liste de tout ce que j’ai cherché mais pas trouvé, tout ce que j’ai effleuré sans pouvoir approfondir, tout ce que j’ai entrevu sans vraiment le lire, et tout ce que je n’ai pas pu (ou su) voir…
Les sources
Je me refuse d’écrire « à la place de », tout au plus puis-je écrire « de la place de ». Pour cette raison, je ne voulais pas faire ce livre en laissant penser qu’il pouvait être une sorte de récit fidèle de ce que vivent « réellement » les personnes en Somalie, sans prendre en compte d’où je parle et des incidences que cela peut avoir. Ainsi, je ne suis jamais allé en Somalie ou dans la région et je n’ai aucun lien particulier avec ce pays, si ce n’est à travers ce que j’en ai lu. Ces lectures ont créé chez moi une attention accrue, une sorte de proximité fictive, pour ce « coin du globe ». D’autant plus fictive qu’il est peu probable que je me rende un jour sur place, le tourisme n’est pas mon fort. Alors pour avoir ne serait-ce qu’une vague idée de ce qui s’y passe, il m’a fallu lire des écrits universitaires. J’en suis souvent réduit à cela si je veux connaître un peu n’importe quel sujet auquel je n’ai pas accès directement. Tout comme vous l’êtes à lire ce livre pour combler votre curiosité sur la Somalie… J’ai parcouru attentivement plus d’une centaine d’articles et plusieurs dizaines de bouquins écrits entre 1950 et aujourd’hui, dont une grosse proportion datent de la décennie 90 et du début des années 2000.
La quasi-majorité des experts francophones de la Somalie ne sont ni d’origine somali, ni somalienne, et tous sont issus d’universités de pays occidentaux. Au long de leurs carrières, ils ne séjournent dans le pays que quelques mois, de manière épisodique. D’autant plus difficilement dans un pays en guerre civile, où il ne fait pas bon se balader. Les diplomates, les humanitaires et les militaires sont généralement ceux qui restent le plus longtemps. Tous ne parlent pas nécessairement somali mais communiquent en anglais avec leurs interlocuteurs « de terrain », ce qui revient à dire qu’il leur est souvent nécessaire de passer par un intermédiaire. La plupart sont des hommes, dont le statut social inhérent à leur qualité de « spécialiste » les classe, au pire, parmi les classes moyennes supérieures.
Et alors, me diront certains ? Et bien, tout cela crée obligatoirement des hiatus, des décalages plus ou moins forts selon les sujets. Prenons quelques exemples en rapport avec la Somalie.
Conditions sociales
Les universitaires et autres experts – hommes et femmes – auteurs des mes sources n’appartiennent pas (ou plus) aux couches sociales les plus basses dans les pays dans lesquels ils officient. De par leurs fonctions, ils sont plus proches du pouvoir ou des institutions en place qu’ils ne le sont d’une critique radicale – et quelques exceptions ne changent rien. Lorsque je lis des écrits universitaires sur des sujets qui me sont beaucoup plus proches que la Somalie, je porte un regard critique et n’oublie jamais qui sont les auteurs afin de mieux discerner en quoi ils produisent un discours sur leur sujet d’études. Je sais qu’il me faut tenter de dénicher les informations intéressantes, selon moi, derrière leurs propres analyses. Idem lorsqu’ils parlent de la Somalie. Je me rappelle toujours la part d’extériorité qu’ils ont avec ce qu’ils appellent leurs sujets, celles et ceux qu’ils jugent être « des autres ». Je n’oublie pas que le statut social conditionne souvent le regard porté sur telle ou telle situation. Leurs interlocuteurs « de terrain » sont généralement des personnes d’une classe sociale proche qui, elles aussi, produisent des discours inhérents à leur classe sociale dans un contexte qui leur est propre. Quelle crédibilité accorder à l’analyse d’un politicien, d’un chef de guerre, d’un commerçant, d’un patron ou d’un religieux sur ce que vivent ou pensent des quidams comme vous et moi. En Somalie ou ailleurs…
Les quelques textes concernant les jeunes somaliens sont assez symptomatiques de ce qu’ils produisent comme discours sur « les jeunes ». Ou plus précisément il permet d’entrevoir la vision qu’ont ces universitaires, dans leurs pays d’origine, de ce qu’ils appellent « les jeunes » ou « la jeunesse », et qu’ils transposent à la situation somalienne. De fait, ils ne peuvent faire autrement que parler « à la place de ». Mêmes poncifs pour un contexte différent lorsqu’ils dissertent sur la violence juvénile, la perte de repères, la rupture de l’autorité parentale ou la consommation de drogue. Il suffit par exemple de se rappeler tout ce que l’on peut entendre ici de délires sur le cannabis pour se demander ce que vaut ce que l’on peut lire sur le khat, sur sa dangerosité sociale ou ses méfaits sanitaires. Pour décrire des tentatives collectives d’autonomie, ils préfèrent y voir des « dérives délinquantes », pour rendre compte du refus de l’autorité des anciens ils insistent sur la nécessité de la tradition pour la cohésion sociale, etc. Quand je repense aux conditions dans lesquelles les sociologues « de terrain » spécialistes des jeunes en France effectuent leurs enquêtes, et croient pouvoir en tirer des analyses géniales et générales, je souris encore plus en pensant à celles réalisées en Somalie ! Ils parlent d’une jeunesse intemporelle sans tenir compte des différences entre la génération de la guerre civile, née pendant le régime de Siad Barre, et celle actuelle, qui n’a jamais connu autre chose que la guerre civile. Un auteur recycle même le « parlé jeune » en utilisant l’expression « sorte de verlan somali » pour décrire une forme de somali parlée dans le Harar et qui, bien loin des processus urbains d’émergence de ce que l’on appelle les verlans, est en fait le résultat d’une somalisation progressive et tardive.
Je ne sais rien des positions politiques de chacun d’entre elles et eux, mais je suis sûr qu’ils ne sont pas anarchistes. Il faut ne pas l’être pour considérer que la Somalie vit dans l’anarchie : ce qui est un leitmotiv dans les analyses sur la situation somalienne. Ils portent peu d’intérêt à interroger les rapports de pouvoir entre collectif et individu ou interindividuels qui naissent de chaque nouvelle situation sociale. Ainsi, leurs regards sont tournés exclusivement vers le jeu politique classique, les enjeux militaires, les institutions en devenir… L’anarchie n’est pour ces universitaires qu’un repoussoir. Ou un fantasme lorsqu’ils voient dans la segmentarité des pasteurs nomades une « anarchie ordonnée » ou dans la guerre civile une forme « d’anarchie armée » !
Les luttes sociales font aussi partie des sujets sur lesquels je n’ai rien trouvé, hormis quelques lignes sur la création de syndicats avant les années 60. De nombreux chiffres remplissent les analyses économiques et politiques mais aucune ne fait mention de conflits sociaux ou de grèves. Même s’il est vrai que la Somalie est un pays où la main-d’œuvre, ouvrière ou agricole, ne représente qu’un faible pourcentage de la population totale, il me semble néanmoins difficile d’imaginer un monde du travail sans conflictualité ! Est-ce à dire que les exploitations coloniales ou les usines d’État sont un exemple de concorde sociale ? Alors qu’au contraire le caractère social des luttes et revendications des anciens esclaves s’exprime clairement, le cadre de la lutte de décolonisation, le discours nationaliste tend à tout noyer dans sa propre rhétorique. Seules des chansons de travail laissent parfois entrevoir une contestation des conditions sociales.
Privilèges & déformations
Être originaire d’une région, d’un pays ou d’une ville n’est pas selon moi la garantie de porter un regard pertinent sur ce qui nous entoure. Je pense en disant cela à beaucoup de personnes que j’ai pu croiser, voisins, familles, collègues ou proches. Idem pour les somaliens, même universitaires. Pour m’en convaincre, il me suffit d’écouter ceux qui, en France, sont spécialisés dans la « société française » ! Souligner l’origine de ces universitaires somalophiles n’a pas pour but de les opposer les uns aux autres, ni de prêter une espèce de neutralité bienveillante à certains plutôt qu’à d’autres, mais de montrer en quoi cela produit des regards différenciés, des points de vue.
Être catégorisé « blanc » – comme moi – dans un pays où cela est la normalité ne permet pas de cerner facilement tous les mécanismes racistes, mais tout au plus de voir les plus visibles, les plus spectaculaires. Lors de mes recherches pour ce livre, je suis tombé sur un documentaire intitulé Noir sur blanc et diffusé par la chaîne Arte dans lequel un Allemand (blanc) se maquille pour ressembler à un Africain (noir), d’une manière qui se veut réaliste. Son but est de déambuler dans différents endroits afin d’expérimenter et de dénoncer le racisme ordinaire. En se faisant passer pour un réfugié Somalien ayant appris l’allemand dans un institut Goethe de la Corne de l’Afrique, il tente ainsi de ressentir ce qu’est le « sentiment d’exclusion ». Bien évidemment il se heurte frontalement ou insidieusement à de multiples formes d’expression du racisme, mais il passe à côté de la quotidienneté de ce racisme. Bien malgré lui, il est porteur de « privilèges blancs », en l’occurrence pour ce reportage celui de ne pas être traité toute sa vie comme il l’a été quelques courts instants. Sont généralement appelés « privilèges blancs » les avantages que l’on tire de cette « couleur de peau », même malgré soi. Par exemple, si vous avez la même tête que moi, il y a de fortes probabilités que vous ne soyez pas traité de la même façon qu’une personne cataloguée « noire » ou « maghrébine » lorsqu’elle est face à une administration, à un patron, à la police ou tout simplement dans la rue face au racisme ordinaire et populaire ! Une manière de « bénéficier » du racisme, de façon involontaire et indirecte. Ces exemples ne doivent pas occulter tous les mécanismes beaucoup plus « subtils » dans les discriminations racistes. Je ne sais pas s’il est plus aisé de les disséquer lorsqu’on les subit plutôt qu’on en bénéficie, mais je constate que les vécus ne peuvent être identiques. Bien sûr la critique peut être commune, mais l’impossibilité de le vivre ne peut qu’être une limite indépassable. Ainsi, lorsque ces spécialistes rendent compte du racisme en Somalie envers les bantou Gosha, j’en déduis qu’ils ne perçoivent pas la totalité de ce qui se joue réellement. Et, bien pire encore, ils reproduisent peut-être eux-mêmes des mécanismes racistes lorsque, par exemple, ils interrogent des Somali sur les discriminations contre les Gosha ou lorsqu’ils demandent à des Gosha de s’exprimer – via un interprète somali – sur leurs conditions de discriminés (par des Somali) ! Ils ne pensent pas un instant que dans ces deux cas, les Somali en question sont les porteurs des « privilèges » du racisme dont ils sont les « bénéficiaires », involontaires (ou pas). Sur cette question du racisme, il est important de préciser une dernière chose concernant les groupes castés en Somalie. Tout ce que j’ai lu à leur propos parle des nombreuses discriminations dont ils sont l’objet, sans pour autant lire toujours clairement qu’il s’agit d’une forme de racisme. De manière assez similaire à ce qu’il se passe en France avec les Roms ou les musulmans, un racisme particulier touche les groupes castés. Cette particularité qui consiste étrangement à différencier un mauvais racisme d’un bon racisme, qui ne dit pas son nom ! Le premier étant moralement inacceptable alors que le second serait justifié par le comportement volontaire des discriminés eux-mêmes – collectivement et individuellement – accusés selon les avis de saleté, de provocation, de fainéantise, de marginalité, de sexisme, etc. Pour ma part, je n’y vois pas autre chose que du racisme. Forme encore plus sournoise de racisme, j’ai lu dans un écrit récent d’un universitaire que le racisme contre les Gosha s’explique par le fait que LE Somali est raciste ! Il ne s’agit pas pour moi de nier l’existence du racisme en Afrique, mais de refuser les arguments racistes pour l’expliquer. Et un autre parle en 1999 d’indices crâniens – comme au XIXe siècle – pour différencier « scientifiquement » les Somaliens entre eux ! Cette distinction entre les discriminations dont sont victimes les groupes castés et celles que vivent les Gosha, bénéficie de fait à ces derniers, qui obtiennent plus facilement des visas accordés aux réfugiés somaliens par les pays désireux de mettre en avant leurs bonnes consciences. Le même mécanisme s’applique aux populations Benadiri et Bravani – arabo-somali de Mogadiscio et Brava – victimes de discriminations qui bénéficient d’une politique favorable en matière de visa, contrairement aux autres groupes castés. La raison indirecte est qu’ils sont considérés plus facilement intégrables, car urbains et souvent de familles de commerçants, sous-entendant ainsi que les autres ne sont que des pauvres !
Dans le domaine des sciences humaines, le savoir produit dans les universités occidentales est l’héritier des disciplines scientistes nées au cours des deux siècles précédents. Elles-mêmes empruntant des pensées, des écrits et des réflexions à leurs « illustres prédécesseurs ». Elles se sont construites en puisant dans ces bagages savants, imprégnés des lieux communs et des théories scientifiques de leurs époques, en les comparant et en les critiquant. Puis, en invoquant la raison, elles se sont imaginées pouvoir proposer des méthodes et des modèles scientifiques d’explication du monde. Rien de moins ! Difficile d’évoquer ces disciplines sans penser aux interactions entre elles et les systèmes politiques qui les portent. Lors de mes lectures somaliennes j’ai dû me confronter à l’anthropologie, l’histoire, la linguistique, la géographie humaine et la (géo)politique. Toutes ces sciences s’entrecroisant d’une manière ou d’une autre. Bien évidemment, ces disciplines ne sont plus les caricatures de ce qu’elles furent par le passé, lorsqu’elles se nourrissaient des écrits de géographes qui n’avaient jamais bougé de chez eux, de récits d’explorateurs qui mélangeaient ce qu’ils avaient vu avec ce qu’ils avaient entendu dire, de comptes-rendus de militaires et d’agents coloniaux, de textes religieux ou de théories scientifiques ouvertement racistes. Mais néanmoins elles restent empreintes d’un vieux fond qu’elles tiennent de l’expansion coloniale des pays européens qui les a vu naître et qu’elles ont accompagné. Voici quelques exemples.
En s’inspirant de travaux sur les sociétés kabyles, le français Émile Durkheim propose en 1893 le terme de segmentaire pour désigner certaines organisations sociales dans lesquelles il n’existe pas de pouvoir politique centralisé. Dans la continuité des présupposés racistes de l’époque, le mythe de la « sauvagerie » est remplacé par celui du « bon sauvage » dont la proximité avec la nature est une marque de liberté. Les sciences humaines aiment à voir dans ce « bon sauvage » une forme d’innocence perdue ! Les réflexions sur la naissance et la nature de l’État en Europe, alors en pleine explosion des nationalismes, poussent certains à opposer le modèle étatique à des modes d’organisation sociale sans État. L’anthropologue britannique Edward Evans-Pritchard – agent du gouvernement à l’occasion – reprend à son compte la définition de Durkheim pour l’appliquer aux observations qu’il fait lors de ses différents voyages entre 1930 et 1936 chez les Nuer du Soudan anglo-égyptien (actuel Soudan du Sud). Malgré la situation difficile que vivent les Nuer après l’écrasement de leur révolte par les Britanniques et le mauvais accueil qu’il reçoit de leur part, Evans-Pritchard publie en 1940 ses travaux sur la société segmentaire des Nuer. La même année il fait paraître un ouvrage intitulé Systèmes politiques africains, dans lequel des anthropologues analysent huit sociétés africaines et proposent un classement entre sociétés à État et sans État, ces dernières étant représentées par les sociétés segmentaires. Mieux vaut de nouveau un petit schéma qu’un long discours. Si le clan A se segmente en deux lignages, B et C, eux-mêmes respectivement divisés en D et E, F et G. Le lignage F se segmente en J et K. Le lignage D forme un groupe distinct de E, tout comme F de G, ou J de K. Mais lorsque D entre en conflit avec F, il y a fusion entre D et E au niveau (le segment) supérieur B afin de s’opposer à F et G, regroupés eux aussi au niveau supérieur C. Quand le conflit cesse, ces fusions disparaissent et chaque lignage retrouve son autonomie. Ce système dynamique s’équilibre dans un jeu permanent et mécanique de fusions et de fissions qui ne permet pas l’apparition d’un pouvoir permanent. Ces sociétés sont dites acéphales (sans tête) et Evans-Pritchard les définit, sans rire, comme des formes « d’anarchie ordonnée » ! Il réitère en 1949 avec son étude sur la confrérie Senoussya, en lutte contre les Italiens dans le sud de l’actuelle Libye. En 1955 il envoie l’un de ses étudiants, Ioan Myrddin Lewis, au Somaliland britannique afin de vérifier ses théories de la segmentarité chez les nomades somali. Lewis publie en 1961 le résultat de ses études sous le titre Une démocratie pastorale: Étude du pastoralisme et de la politique chez les nord-Somali de la Corne de l’Afrique. Dans ce livre, il insiste sur l’aspect fondamental de la segmentarité (clans, lignages et familles) chez les Somali, et en fait même un mécanisme primant sur tous les autres, structurant l’ensemble des relations entre Somali. L’organisation sociale des Somali est présentée comme une société égalitaire. Ces théories sur la segmentarité sont en partie contredites par d’autres anthropologues qui les jugent trop mécaniques et donc loin de refléter la complexité des rapports sociaux. Des travaux sur d’autres sociétés dites segmentaires ont permis de mettre en évidence qu’elles n’étaient pas un obstacle à l’émergence de pouvoirs politiques et/ou religieux. D’autres encore ont pointé le fait que des contrats et des alliances souscrites entre des familles ou des lignages n’appartenant pas aux mêmes clans peuvent prendre le dessus sur la segmentarité. Je peux ajouter qu’il s’agit aussi de savoir ce qu’il voulait voir, car il aurait pu tout autant appuyer sur le côté fluide et adaptatif du système segmentaire, porté par l’oralité, plutôt que sur la mécanique des clans et des lignages qu’il rigidifie en lui donnant un aspect scientifique. De manière un peu identique à une description anthropologique de la France qui placerait au centre la structure familiale patrilinéaire et patriarcale, fidèle et hétérosexuelle, sans voir toute la diversité de situations ou de pratiques réelles ! Pour l’ensemble de ses travaux sur la société somali (langues, histoire, coutumes) Lewis est devenu la référence incontournable – mais critiquée – pour les Somali Studies, jusqu’à sa mort en 2014. Lorsque paraissent les premiers écrits de Lewis sur le Somaliland, celui-ci est en pleine effervescence indépendantiste, mêlant nationalisme pan-somali et somalilandais. Difficile de dire qui alimente qui, mais les travaux de Lewis servent alors de caution scientifique à un pansomalisme dont les clans seraient l’essence même. Tout autant qu’ils fournissent un argumentaire aux ambitions politiques britanniques qui visent une Somalie réunissant tous les Somali, sous la houlette du Royaume-Uni. Il établit aussi une carte de l’espace linguistique somalophone pour laquelle il applique une méthode incluant bon nombre de locuteurs ayant des langues que des études plus récentes classent autrement, plus subtilement. Cette même carte dont Siad Barre se servira pour justifier sa politique nationaliste. De manière générale, les travaux de Lewis ont laissé leur marque dans l’enseignement des Somali Studies, et beaucoup d’auteurs ont toujours tendance à survaloriser l’importance de la structure clanique somali dans le jeu politique. L’exemple de la guerre civile montre assez bien que les dynamiques dépassent le cadre clanique et obéissent aussi à des logiques qui peuvent être politiques, économiques, religieuses, etc. J’ai ainsi cherché à savoir l’importance des mariages mixtes entre Somali de clans différents. Seul un texte récent mentionne que les mariages entre Darod et Hawiye, ou Darod et Dir dans les décennies 1970 et 1980 ne sont « pas rares » dans les milieux urbains.
L’écriture de l’histoire de l’Afrique subsaharienne s’est faite en grande partie par des sources arabes et européennes, il existe en proportion très peu de documents écrits africains. Qu’elles soient arabes ou européennes ces sources sont toujours pleines de présupposés sur les civilisations et les populations d’Afrique, essentiellement décrites ou étudiées par ce prisme extérieur. Ce sont ces présupposés qui définissent les Africains en négativité. L’Afrique « noire » est vue comme un vaste continent hostile et inexploré, peuplé de tribus sauvages et barbares, sans histoire. L’islamisation et la christianisation du continent ont peu changé le regard porté par les musulmans arabes ou les chrétiens européens. L’esclavage, l’exploration puis la colonisation de l’intérieur des terres par les États européens vont nourrir des discours, fluctuant selon les époques, qui essentialisent les Africains. Lorsque cela est nécessaire on évoque leur supposée sauvagerie pour valoriser tel ou tel pays européen, et à l’inverse on les imagine dans un état de nature « paradisiaque » pour les opposer à l’oppression étatique en Europe. Les Africains deviennent une somme d’archétypes pratiques. Ces procédés sont utilisés dans toutes les formes de racisme et ne concernent pas que l’Afrique, mais celle-ci, malgré tout, détient sans doute le triste record des préjugés. Dans la première moitié du XXe siècle, des intellectuels et des universitaires d’origine africaine formés dans les universités d’Europe, imprégnés de leurs méthodologies, commencent à constituer une réponse à toutes ces visions ethnocentrées. Le but de ce panafricanisme universitaire est de faire une autre histoire de l’Afrique. S’il est vrai que ces nombreux travaux ont permis une meilleure appréhension générale de l’Afrique, de faire connaître des pans entiers de l’histoire de royaumes et empires africains et de remettre en cause les discours officiels sur l’absence d’histoire, une méthodologie similaire – même inversée – ne pouvait éviter les mêmes écueils, les mêmes raccourcis. Pour ne citer que quelques exemples, il suffit de rappeler l’acharnement de ces panafricanistes à voir dans l’Égypte pharaonique ancienne un royaume purement africain, à survaloriser les traditions et les coutumes, à faire de l’Afrique une unité sociale, à relativiser le rôle des royaumes ou des pouvoirs africains dans la traite esclavagiste arabe ou transatlantique, ou la collaboration d’élites locales avec le pouvoir colonial, etc. Cela s’explique très bien au vu des enjeux historiques dans une situation politique coloniale de contestation et de volonté d’indépendance. La neutralité et l’objectivité scientifiques n’existent pas, et les universitaires africains sont, comme les autres, les produits, les acteurs et les cautions nécessaires aux enjeux politiques de leur époque. La Somalie est à la croisée des problématiques soulevées par ces intellectuels et universitaires, africains et européens. Dans l’espace somali, hormis des textes religieux, l’histoire collective est portée par de multiples formes d’oralité (poèmes, chansons, mythes, etc.) jusqu’au XIXe siècle. La puissance du royaume d’Éthiopie depuis des siècles occulte largement le pastoralisme nomade somali qui se trouve dans sa périphérie. Les cités-États de la côte de l’océan Indien sont présentées comme des comptoirs arabes, desquels les Somali sont étrangers. Les divers sultanats somali sont eux aussi peu connus, leur autonomie dévalorisée, et leur histoire se confond avec celle des empires qui les convoitent et parfois les soumettent. Dans tous les livres récents d’histoire générale de l’Afrique que j’ai lus, ou simplement de la Corne, la Somalie représente toujours une toute petite partie. Néanmoins, les nouvelles approches historiques ont mis en évidence le rôle important du pastoralisme somali dans le commerce local et si l’on recentre le regard sur l’océan Indien, entre l’Afrique, la péninsule arabique et l’Asie, les liens économiques et politiques entre les cités-États de la côte et les groupes nomades ou d’agriculteurs s’avèrent plus complexes que ce que laissaient imaginer jusqu’à maintenant les écrits sur le sujet. Contrairement à une vision stricte de la segmentarité, les différents sultanats et émirats de la Corne sont aussi l’émanation de lignages somali, en conséquence de quoi il est maintenant impossible d’affirmer sérieusement que la société somali est étrangère à toute structure étatique ou para-étatique. Tout comme il est difficile de s’appuyer sur les traditions ou les mythes somali pour confirmer ce qu’ils affirment sur les migrations des Somali vers la Corne, l’islamisation, les origines arabes, les castes, etc.
La géopolitique moderne souffre aussi des mêmes maux. Par déformation elle décrit le jeu des « grandes puissances » dans lequel les petits pays n’ont que des rôles subalternes, plutôt que l’état des rapports entre les pays. Ainsi les différentes situations en Afrique sont souvent caricaturées comme étant les résultantes exclusives des politiques européennes. Ce raisonnement s’inscrit dans une vision très XIXe siècle de l’Afrique, celle d’un continent sans histoire que les Européens forgent au fil des siècles ! Que ce soit la pensée « néo-coloniale » ou ses pourfendeurs anti-impérialistes, la tendance est de minimiser l’existence de dynamiques locales ou régionales. La première s’imagine indispensable afin « d’éviter le chaos », alors que les seconds pensent que tout est dû aux politiques des États européens. De nos jours, les discours politiques ou médiatiques sont encore farcis de ces vieux réflexes. Il suffit de voir avec quelle facilité une guerre est qualifiée d’ethnique, de religieuse ou d’ancestrale, pour des situations en vérité bien plus complexes. L’anti-impérialisme radote sur les conséquences néfastes – bien réelles – des frontières héritées de la décolonisation et des politiques néo-coloniales des anciennes métropoles pour tout expliquer. Et pourtant, la Corne de l’Afrique n’a pas attendu les colonisateurs européens pour expérimenter l’expansionnisme, celui de l’empire d’Éthiopie, et connaître des conflits et des guerres pour des territoires. Les Somali ne vivaient pas dans la paix et la concorde avant d’être fragmentés en plusieurs pays, et la guerre civile ne peut s’expliquer seulement par l’échec de l’État post-colonial et le jeu des « grandes puissances ». L’arrivée à partir du XVIIIe siècle des colonisateurs européens ne doit pas être prétexte à simplification mais plutôt être vu pour ce qu’elle est : un nouveau protagoniste – pas des moindres, certes ! – dans un environnement politique et social existant. Cette nouvelle donne n’efface pas toutes les autres, elle s’y entremêle à des degrés divers. La reprise du qualificatif post-colonial pour désigner et justifier des travaux historiques et sociologiques actuels, ou des discours politiques et militants, renvoie d’ailleurs en partie à cette illusion d’un avant et d’un après. Avec parfois un brin d’essentialisme…
Où sont les athées, les incroyants, les kafir ? Je sais qu’il est toujours très difficile de s’affirmer athée, et encore plus antireligieux, dans la plupart des pays de tradition islamique – même laïcs – sans s’exposer dangereusement. Mais je pense que les présupposés sur la religion musulmane empêchent aussi de voir celles et ceux qui n’accordent aucune véracité aux croyances religieuses, mais les vivent en tant que contrainte de l’environnement social. En effet, alors que dans beaucoup de pays de culture chrétienne la différenciation est faite entre pratique religieuse et appartenance à ces pays, lorsqu’il s’agit de pays musulmans le raccourci est vite fait. Il est ainsi assez courant d’entendre dire que toutes les personnes habitant dans un pays de culture islamique sont musulmanes – hormis les minorités religieuses – laissant bien peu de place à d’hypothétiques athées. Une autre manière d’essentialiser des groupes humains, dans une région où l’histoire politique et intellectuelle contemporaine n’est pourtant pas étrangère aux débats qui traversent la planète : pour preuve, l’existence d’une guérilla communiste à Oman ou de régimes laïcs « progressistes » au Sud-Yémen, en Éthiopie et en Somalie. Quant à la présence d’anarchistes en Somalie, j’ai cherché mais je n’ai rien trouvé…
Pas son genre…
De tous les articles écrits en français sur la Somalie, la quasi-totalité le sont par des auteurs masculins (dont moi-même). De la même manière qu’avec les privilèges liés au racisme, ces hommes ne sont pas réellement en mesure de capter toutes les réalités des femmes. Bien sûr, ils parlent tous de leurs conditions sociales mais n’y consacrent généralement – au mieux – qu’un chapitre pour tracer un portrait des femmes somali qu’ils décrivent dominées, soumises. Il m’a fallu chercher longtemps pour trouver quelques articles écrits par des auteures qui, elles, ont consacré des études sur les conditions des femmes en tentant d’avoir une autre lecture des choses. Mais j’en avais tellement peu que j’ai même dû recourir à mon anglais scolaire pour compléter un peu mes sources. L’absence d’un sujet dans un texte n’est pas une preuve de son inexistence mais bien souvent un indicateur de qui regarde, et qui montre le peu d’intérêt porté. Les auteurs masculins – mais pas que – prennent en référence une norme, le genre masculin, duquel est défini son pendant féminin. Et cela dans tous les domaines de la vie sociale, politique, culturelle, etc. L’invisibilité des femmes répond à ce mécanisme. Le caractère limité du récit se retrouvent aussi dans les écrits universitaires. Difficile de trouver des écrits sur les violences contre les femmes et plus encore sur leurs moyens de se préserver ou de se défendre. Je n’ai rien lu sur l’existence de méthodes contraceptives ou abortives, locales ou non – interdites depuis l’indépendance de la Somalie. Pas beaucoup plus de choses sur les contaminations par le HIV lors de viols, hormis sur la mise en place de campagnes de prévention. Dans tous les chiffres sur les migrants, il n’est jamais fait mention de la proportion de femmes, si ce n’est lorsqu’elles apparaissent dans les listes de naufragés. Et cetera.
Lorsque ces universitaires parlent des femmes, ils les cataloguent selon leur strict rôle social. Ils aiment à rappeler la polygynie, les mutilations génitales, les conditions matérielles, le peu d’influence sociale, l’illettrisme ou les violences – qui sont des réalités. Ils les dénoncent tout en portant un regard qui place les femmes dans un unique rôle de victime. La plupart des textes ne mentionnent par exemple pas de situations conflictuelles entre hommes et femmes, laissant imaginer que ces dernières acceptent pleinement leur rôle social, ni de parcours individuelles ou d’éphémères tentatives. Cette absence donne surtout une image de la vision de l’auteur sur ces problématiques de domination de genre, et de ses présupposés sur ce que sont censées être « les femmes ». D’autres auteures ont permis de valoriser toute une somme d’actions collectives ou individuelles, des situations conflictuelles ou des formes de révolte dans des domaines très divers. Elles ont décrit les gestes d’entraide, de solidarités économiques pour se constituer des pécules – ce que l’on appelle des tontines – ou l’existence d’une riche oralité poétique féminine. La poésie somali est un bon exemple d’invisibilité : les premières études ne font pas mention de cette oralité, qu’elles n’ont pas su voir, et décrètent que la poésie est une activité masculine dans la culture somali, la qualifiant même de « nation de bardes » ! Dans ces quelques textes – en anglais – j’ai croisé des poétesses qui étaient plus en verve à dénoncer les conditions des femmes qu’à exalter une féminité à la mode somali. Plus véhémentes à critiquer le sexisme des traditions qu’à défendre la masculinité somali. Dans beaucoup des chansons de travail, des berceuses, des chants religieux ou des maximes que j’ai lus, il existe un double sens qui laisse entrevoir une vision féminine de cette condition. L’activisme politique est aussi un bon marqueur de cette invisibilité. La présence de femmes tout au long des luttes pour l’indépendance est chose avérée, autant par des textes des colonisateurs que par des déclarations politiques d’organisations nationalistes somali ou, là encore, par des poétesses. Elles n’ont pas obtenu pour autant une amélioration de leur condition sociale et certaines ont alors décidé de s’organiser séparément en tant que femmes. Très peu d’informations sont à ma disposition sur les groupes ou luttes de femmes au cours du XXe siècle, que ce soit avant ou après l’indépendance. Les seules un peu détaillées sont celles produites par l’organisation féminine officielle du régime de Siad Barre, qui parle d’avancées dans la lutte contre l’excision et l’illettrisme. Mais quel crédit leur porter ? Pour la période de la guerre civile, pendant laquelle les femmes sont les plus touchées, je n’ai trouvé que quelques mentions éparses que je cite dans ce livre.
Tout comme les questions de genre, la sexualité est évacuée par tous les auteurs – hommes ou femmes. J’ai par exemple cherché à savoir ce qu’il en était de l’homosexualité en Somalie en postulant que, comme dans beaucoup de pays musulmans, elle existe sous des formes codifiées autres que celles que nous connaissons en Europe. La seule mention trouvée est celle de son interdiction dans la nouvelle République somalienne par une loi de 1962, applicable en 1964, avec des peines de prison allant de trois mois à trois ans pour « rapport charnel avec une personne du même sexe ». Des « mesures de sécurité publique » sont ajoutées afin de pouvoir enfermer ou expulser celles et ceux dont l’homosexualité est un risque pour l’ordre public ! Dans les faits, cela s’est traduit, entre autres, par des placements en orphelinat. Aucun chiffre concernant des condamnations n’est disponible. Ces lois sont maintenues jusqu’en 1991, date de l’effondrement de l’État somalien, puis reprises dans le code pénal du Somaliland et du Puntland indépendants. Au sud, sous domination des islamistes d’al-Shabaab, l’accusation d’homosexualité est passible d’une mise à mort, souvent par lapidation. Les médias et les associations LGBT somali, en Éthiopie et au Royaume-Uni, ont relayé quelques cas d’hommes et de femmes. Les témoignages parlent de l’extrême difficulté à vivre publiquement son homosexualité – dans toute l’ex-Somalie – sans risquer de s’exposer à un rejet familial ou sociétal, souvent violent. Ceux qui se prostituent à Nairobi, la capitale kényane, sont parfois arrêtés lors de rafles policières et menacés d’être renvoyés en Somalie, malgré le risque de mort. Au Kenya, il existe diverses associations somali qui prennent en charge les personnes infectées par le HIV – homosexuelles ou non. D’Éthiopie, où elle est basée, une association somali queer témoigne dans le début des années 2000 de l’existence de personnes transgenres et décrit des conditions sociales tout aussi difficiles que pour celles homosexuelles. Je ne sais pas combien de personnes ont pu invoquer la situation faite aux homosexuel.le.s afin d’obtenir un statut de réfugié dans certains pays d’Europe ou d’Amérique du Nord.
Çomali ?
La liste des thèmes sur lesquels je n’ai rien trouvé dans mes lectures est longue. Mais pouvait-il en être autrement ? Les exemples précédents montrent quelques limites de ma démarche d’écrire ce livre. Elles ne sont pas les seules, car c’est ma démarche qu’il convient aussi d’interroger. Je ne cherche aucune légitimité mais seulement à équilibrer ce paradoxe qui consiste à opposer le fait de ne pas pouvoir parler de tout, à celui de se résoudre à n’écrire sur rien. Poser le problème de la légitimité est presque secondaire, car je ne pense pas l’être moins qu’un universitaire ! À ceci près que pour moi, il est impensable de faire l’impasse sur les limites de ce que j’écris. Néanmoins, j’imagine que ma démarche – critiquable – sera critiquée. Je sais que si je devais lire un livre écrit de Somalie dans une démarche identique pour expliquer ce qu’il se passe en France, il me semblerait tout aussi généraliste, plein de raccourcis, passant à côté de toute une somme de faits, de réalités et d’analyses qui font mon quotidien. Je me retrouverais noyé dans une histoire générale, ramené à la catégorie « français » ou d’autres que j’exècre, réduit à une composante d’une société dans laquelle je ne me reconnais pas… Très loin de la critique que je porte sur ce qui m’entoure. Ce qui est sûr, c’est que je n’aurais pas écrit le même livre, y ajoutant au minimum une approche critique ! J’aurais par exemple tenté de rendre plus visible toutes les formes de transgressions des normes et des mécanismes généraux, plutôt que de les mettre en avant. Chose qui ne m’était malheureusement pas possible pour ce livre autour de la Somalie. Faute de temps et place, il n’était pas pensable que je puisse me lancer dans quelques critiques plus poussées de certains concepts anthropologiques, de problématiques linguistiques et autres pourvoyeurs de mythes et d’ordre des choses.
J’ai tenté d’être attentif à ne pas généraliser, mais il est difficile de trouver un équilibre entre une précision pointilleuse et un résumé « fidèle ». Il faut garder en tête que le terme somali désigne toujours un ensemble multiple et non un groupe uniforme qui répondrait à ses propres règles. Derrière un nom de clan il y a toujours plusieurs lignages ou familles, et toutes ne participent pas au pouvoir. Et tous les lignages ou familles sont composés d’individus différents, dont les choix ne sont pas toujours identiques à ce que veut la norme. Comme partout ! Par nature, les descriptions anthropologiques sont des raccourcis. Les conditions sociales des femmes ne doivent pas laisser penser quoi que que ce soit sur le sexisme en Afrique et faire oublier qu’il existe aussi ici, d’où j’écris, sous des formes qui lui sont propres. Une même description anthropologique formelle de la France ne donnerait pas une situation idyllique ! À de nombreux endroits au fil de ce livre, il aurait fallu ajouter « comme partout » ou « comme là, ou là » afin de ne pas rendre exotique telles ou telles remarques. À vous de le faire.
Les vécus individuels et collectifs de chaque Somalien, homme ou femme, sont évidemment les grands absents de ce livre. Mais cela fait partie des limites que je ne pouvais pas dépasser. Bien sûr de nombreux témoignages sont disponibles, racontant la vie dans des camps de réfugiés ou des récits de la guerre civile, mais il me semblait étrange de devoir en choisir certains plutôt que d’autres. Selon quels critères ? Les plus larmoyants, les plus « véridiques », les plus « quelque-chose » ! Il a d’ailleurs été moins compliqué d’écrire sur les périodes les plus anciennes, historiques, que sur la période actuelle tant les enjeux sont pour moi différents. Je ne voulais pas donner l’illusion d’une description détaillée d’un quotidien, d’un vécu que j’ignore. Je ne peux que l’imaginer et le déduire de ce que je lis, comme vous l’avez fait en lisant ce livre. Bien que par toutes ces lectures mon envie était de mieux appréhender le présent en Somalie, ce livre ne pouvait prétendre être autre chose que ce qu’il est. Si un jour je rencontre un Somalien, je le laisserai me raconter… et à sa question de savoir si je connais la Corne de l’Afrique, plutôt que lui répondre « Un peu ! », je lui dirai sans doute waxda, « Rien ! »