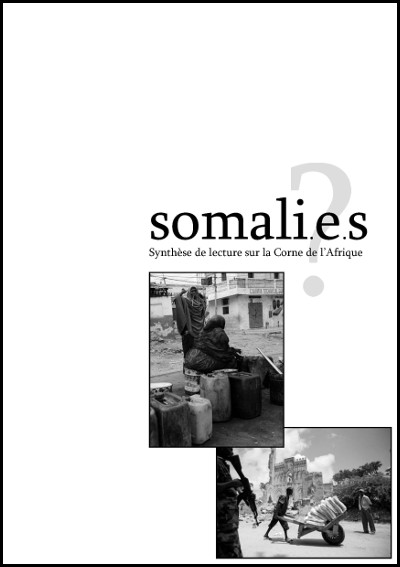Il serait ici trop fastidieux de me lancer dans une description détaillée de ce qu’il se passe dans le futur Djibouti ou dans les territoires somali d’Éthiopie et du Kenya. J’y ferai mention lorsque cela le nécessitera, mais par la suite, je me concentrerai principalement sur la République somalienne et ses décombres.
République & alentours
La nouvelle République de Somalie se fonde sur un régime parlementaire dans lequel la répartition des pouvoirs est « attentive » à l’équilibre nord et sud, et entre les clans. La nouvelle assemblée donne 90 sièges au sud et 33 au nord et le gouvernement comprend six Darod, quatre Hawiye, deux Isaaq et deux Rahanweyn. La volonté « d’unifier tous les Somali » – c’est-à-dire le pansomalisme – est inscrite dans la constitution. Le discours nationaliste est plus présent dans les organisations politiques du sud – plus empreintes de nationalisme arabe – que dans celles de l’ex-Somaliland, mais toutes font de la lutte contre le « tribalisme » leur priorité. S’ils sont l’un des fondements de la répartition des pouvoirs, les clans vont dans le discours être dénoncés comme néfastes à l’unité des Somali. La concentration des pouvoirs à Mogadiscio, devenue capitale, affaiblit certains clans du nord qui voient la ville d’Hargeisa décliner et perdre de son importance, suscitant du désintérêt pour le jeu politique. À peine 30 % de la population de l’ex-colonie britannique participent – hommes et femmes – au premier référendum organisé en 1961. En décembre de cette même année, des militaires Isaaq tentent un coup d’État, avorté, pour protester contre la situation au nord et dénoncer la main-mise du sud, l’ex-Somalia. Pendant les neuf premières années de l’indépendance, alors que les effectifs ont doublé, le nombre d’écoles publiques ne cesse de chuter, principalement celles considérées trop coûteuses dans les campagnes. Seules les écoles coraniques et les madrasa se développent et représentent en 1969 environ 31 % des scolarisés. À la recherche d’une meilleure situation économique entre 200 000 et 300 000 Somali, éduqués, quittent le pays et migrent vers les pays du Golfe dans les années qui suivent l’indépendance. En 1968, de nombreuses grèves dans les usines et les ateliers secouent le pays. Lors des élections générales de 1969, environ 1200 candidats et 62 partis se disputent les 103 sièges à pourvoir. Hégémonique et considérée maintenant majoritairement composée de Darod, la Ligue de la Jeunesse Somali (LJS) en remporte 73, les autres se répartissent entre une trentaine de partis. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces quelques années qui suivent l’indépendance, mais simplement en dire qu’elles furent faites de disputes entre les nombreuses organisations politiques, issues de clans ou d’alliances entre eux, mais aussi de discordes et de petits arrangements entre les pouvoirs traditionnels et les nouvelles élites politiques qui émergent et les marginalisent.
Des épouses de politiciens, alliées à des femmes des classes moyennes, fondent en 1959 l’Association des Femmes Somali. Par le lobbying, leur but est l’ouverture de la vie politique somalienne aux femmes et leur représentation dans les instances et les postes de décisions. 1962 est l’année où, pour la première fois, une femme termine le cycle universitaire complet avec succès. Hormis le droit de vote, peu de choses sont accordées aux femmes et la tradition qui les exclut du pouvoir se perpétue dans les instances du nouvel État. Face à l’immobilisme, les discours se radicalisent tout au long des années 60. Le Mouvement des Femmes Somali, apparu en 1967, réclame l’égalité des sexes et appelle les femmes à se regrouper et à mettre en commun leurs énergies pour prendre ce qu’elles veulent, sans attendre que des hommes acceptent de le leur donner. Le seul témoignage direct que j’ai pu lire en français est celui publié sous le titre Aman. Sous ce pseudonyme, cette jeune fille raconte sa vie en Somalie entre les années 50 et le début des années 70, et à travers son récit celle de sa mère. Désireuse de rester autonome la mère d’Aman tente de concilier respect des traditions et petits arrangements. Après plusieurs divorces, elle est cheffe d’une famille composée de sa propre mère et de ses quelques enfants, dont Aman, et vivant dans un village du Benadiri. Elle multiplie les petits boulots, se lance dans l’élevage, le commerce ou l’artisanat… mais ils sont souvent pauvres. Le père d’Aman ne vit pas avec elles. Issu d’un clan important, il occupe la fonction de chef, c’est-à-dire qu’il est rémunéré par les autorités coloniales italiennes pour veiller à la bonne marche de l’ordre politique et social au niveau local. Ce texte à la première personne relate le quotidien d’Aman, il est son témoignage des contraintes sociales du mariage arrangé, de l’excision, de la situation des femmes mais aussi de la pauvreté, du poids de la tradition et des clans, de la pression familiale, de la situation politique, etc. Son récit est aussi celui d’une jeune fille qui décide d’échapper à sa condition sociale. Elle côtoie l’univers urbain de Mogadiscio dans lequel elle survit de débrouilles et expérimente un nouveau style de vie, symbole de « modernité ». Elle se confronte au racisme réciproque entre Somali et Italiens, à l’ambiguïté des rapports amicaux et/ou financiers que des femmes somali – dont Aman – entretiennent avec certains Italiens afin de survivre, à des relations sociales non plus basées sur les lignages mais sur un rapport libéral, à la permanence de coutumes traditionnelles derrière le masque d’une nouvelle modernité… Elle décrit la vie d’une partie de la jeunesse pauvre qui profite de ce milieu urbain pour s’émanciper de certaines contraintes sociales et tenter de s’insérer dans la nouvelle classe moyenne urbaine. Classe moyenne composée de petits commerçants ou fonctionnaires, et leurs enfants, d’étudiants, d’enfants de notables ou de colons, et de « débrouillard.e.s » de tous genres… Les jeunes urbains les plus pauvres veulent aussi accéder à cette modernité urbaine que sont la mode, le cinéma, les restaurants, la musique, la politique, les bars ou l’université. Pour cela il faut de l’argent, certains l’obtiennent par de petits boulots plus ou moins réguliers, plus ou moins légaux. Ces jeunes – garçons et filles – sont généralement mal considérés par leurs aînés. Les filles sont traitées de sharmuuto (prostituée) surtout lorsqu’elles décident de se faire « entretenir » comme Aman ou certaines autres jeunes filles dont elle parle. Cette tranche de vie parle aussi de solidarités féminines, certaines par affinités entre des femmes et parfois par nécessité de la survie. Selon les règles traditionnelles elles sont en équilibre permanent sur la corde raide de l’acceptable. Aman tente, sans succès, de se faire une place dans la classe moyenne urbaine. Finalement elle décide de quitter la Somalie. Il est bien évidemment impossible de généraliser à partir de l’histoire d’Aman mais elle donne un aperçu intéressant de possibilités individuelles dans le contexte somalien de l’époque.
Dans les territoires du District de la Frontière Nord de la colonie britannique – futur Kenya – vivent environ 250 000 Somali. La libéralisation de 1960 et la mode du pansomalisme font éclore trois organisations politiques somali dont la finalité est le rattachement à la République somalienne voisine. Elles comptent sur un soutien britannique à leurs revendications sur les frontières et les zones de nomadisme. Mais malgré les protestations de la Somalie, les autorités britanniques, soucieuses de préserver de bonnes relations avec le Kenya prochainement indépendant, décident d’intégrer cette région pauvre dans les frontières du futur État. Lors de leur accession à l’indépendance, en 1963, les nouvelles autorités kényanes déploient leurs forces armées et se lancent dans une féroce répression de toutes les revendications somali. Le terme shifta, utilisé généralement dans le sens de bandit dans la Corne de l’Afrique, est repris péjorativement par les autorités kényanes pour désigner les rebelles somali, soutenus par la République somalienne, qui mènent difficilement des attaques contre leurs forces militaires jusqu’en 1967. Cette année là, les accords de paix entre la Somalie et le Kenya sont un revers définitif pour la rébellion et le début de la « villagisation » des nomades somali. Propice au contrôle des populations et héritée de pratiques coloniales, cette politique vise à contraindre à la sédentarisation et au développement de l’urbanisation par des politiques de déplacement et de regroupement de populations dans des villages créés pour l’occasion. Plus de 150 000 d’entre eux vont migrer vers des camps de réfugiés de l’autre côté de la frontière somalo-kényane, puis revenir progressivement.
Le nationalisme somali et la politique de la République somalienne voisine n’ont qu’un faible impact sur la vie politique de la colonie française. Les équilibres politiques se sont cristallisés autour de la représentativité et des retombées économiques entre Afar et Somali, divisés – et parfois opposés – entre les Dir Issa autochtones et ceux venus de l’ex-Somaliland. Bien que les Afar soient hégémoniques dans la vie politique et économique, les Issa ne sont pas tentés par le pansomalisme et leurs élites ont fait allégeance à la France. En 1963, des accords sont conclus entre les différentes autorités du territoire et la République somalienne afin de calmer les prétentions de cette dernière. Les contestations et les quelques émeutes du milieu des années 60 contre la main-mise afar contraignent le pouvoir colonial à proposer un référendum pour un nouveau statut du territoire. Qualifié de mensonger par les autorités somaliennes, ce scrutin de 1967 évince la moitié du corps électoral d’origine somali et se conclut donc par une victoire du oui qui transforme ce territoire en Territoire français des Afars et des Issas, sans usage du terme somali.
Confrontée aussi à des mouvements de révoltes et des affrontements armés soutenus par la République somalienne peu après son indépendance, l’Éthiopie met en place un système de représentativité des Somali au sein de l’assemblée nationale et du sénat. Comme pour la guerre au Kenya, la Somalie décide en 1967 de signer un accord avec son voisin, afin de calmer le risque d’emballement et de stabiliser sa propre situation. Le pansomalisme est soluble dans les intérêts du nouvel État. Malgré cette pacification, les régions somali d’Éthiopie restent remuantes.
Socialisme somalien ?
L’échec du pansomalisme et les dysfonctionnements du jeu politique sont parmi les déclencheurs du futur coup d’État. Mais l’assassinat du président de la république par l’un de ses gardes du corps le 15 octobre 1969 est la goutte d’eau de trop, celle qui fait basculer les équilibres fragiles de la politique somalienne. Sans un coup de feu, le 21 octobre 1969, une partie de l’armée prend le pouvoir à Mogadiscio et dans les principaux points stratégiques avec le soutien des quelques organisations de la gauche révolutionnaire somalienne. Un Conseil suprême composé de 24 militaires suspend alors toutes les institutions et les partis politiques, et annonce un an plus tard que « le socialisme scientifique est le nouvel objectif de la République démocratique de Somalie » dont les principaux obstacles sont le « tribalisme » – comprendre le système de clans – et l’extrémisme religieux. Mêlant discours nationaliste et projets réformistes, le nouveau pouvoir met en place un régime militaire autoritaire qui s’effritera doucement, avant de s’effondrer une vingtaine d’années plus tard. Dans la grande foire de la géopolitique de l’après-guerre, cette République démocratique se range dans le camp des Soviétiques, jusqu’à ce que ceux-ci l’abandonnent pour lui préférer l’Éthiopie. L’armement, les experts et les soutiens financiers et politiques sont russes jusqu’en 1977. Dès leur arrivée au pouvoir, les révolutionnaires somaliens, nationalistes et laïcs, menés par Mohamed Siad Barre (prononcez Barré), issu des Marehan, organisent un système de parti unique soutenu par un maillage policier et l’omniprésence de l’armée. Ils mettent en place une somme de réformes et de travaux de modernisation pendant les quelques années de « révolution » : de la scolarisation au déplacement forcé de populations, de la collectivisation à la répression féroce, de l’amélioration de l’irrigation à la guerre contre l’Éthiopie, de l’égalité des sexes aux camps de réfugiés, de la gratuité des soins aux tortures de prisonniers, de la campagne d’alphabétisation au culte de la personnalité… Au fil des années, l’assise du pouvoir qui reposait sur un « savant dosage » des équilibres entre certains clans s’est rétrécie jusqu’à ne concerner que Barre et ses alliés parmi les clans Marehan, Ogaden et Dulbahante, tous Darod, tous placés à des postes stratégiques. La faillite économique et politique, les dissensions et les contradictions internes, les contestations sociales ou régionales en sont venues à bout.
La lutte contre les clans est un des leitmotive du socialisme « à la somalienne » : des lois anti-claniques sont promulguées, interdiction est faite de faire mention de ses filiations, des expressions langagières sont bannies et de faux enterrements sont même organisés dans les rues du Mogadiscio des années 70 pour en symboliser la fin. Le « clanisme » est désigné source de tous les maux de la société, responsable de l’impasse de la première République issue de l’indépendance et coupable d’empêcher l’émergence d’un sentiment national. « Une arme aux mains des réactionnaires » ou « suppôt du néo-colonialisme » pour paraphraser le discours officiel. Parmi les mesures prises, certaines visent particulièrement à diminuer la dépendance économique des individus vis-à-vis de leurs clans en faisant prendre en charge par l’État des obligations financières que seules les solidarités lignagères permettent habituellement de régler : scolarisation, funérailles, mariages et prix du sang par exemple. Pour ce dernier, l’idée est de faire assumer la mise à mort par l’État afin de mettre fin aux dynamiques de vengeance au sein des clans. Des individus appartenant à des groupes castés sont nommés à des postes administratifs ou politiques importants, et la coutume qui « permet » à un individu hors-clans de prêter allégeance à un clan – c’est-à-dire de se soumettre économiquement – est interdite. Des lois instaurent une égalité des sexes, à contrario d’une situation sociale de ségrégation bien établie parmi tous les clans. Les rapports avec les autorités traditionnelles locales sont eux aussi remaniés pour mieux correspondre aux attentes étatiques. Jusqu’alors simple appareil de pouvoir depuis l’indépendance, l’État se transforme en outil d’intégration à un projet politique. Il tente de faire sortir partiellement les Somali des solidarités et des contraintes du système clanique traditionnel, pour mieux les intégrer dans ses propres structures de solidarités et de contraintes. Stratégie somme toute assez répandue d’un État en recherche de légitimité et de citoyens reconnaissants et obéissants, par la force si nécessaire ! Derrière ces nouvelles lois qui au mieux concernent les urbains, ceux que les migrations et les brassages récents ont un peu marginalisés ou éloignés des clans, se cache la réalité de l’exercice du pouvoir. S’il est vrai que les membres des premières instances issues du coup d’État appartiennent à différents clans, un soin particulier est apporté aux choix et aux alliances conclues permettant une meilleure assise du nouveau pouvoir. Paradoxalement les dirigeants somaliens s’appuient sur les clans pour les neutraliser, alors que les clans, eux, aspirent à plus de pouvoir en utilisant la machine étatique. Ne pouvant faire sans au risque de nier la réalité, et n’ayant pas la capacité de faire contre, le pouvoir révolutionnaire fait avec. À ce petit jeu, il est ardu de pronostiquer un vainqueur. Par exemple, le pouvoir de Mogadiscio neutralise les Majerteen en réprimant les pasteurs nomades d’une part, et en accordant d’autre part aux élites urbaines une promotion économique qui ne les incite pas à la solidarité clanique. Pour les Isaaq le processus est différent. Présents dans les arcanes du pouvoir politique ou économique, les élites Isaaq sont victimes de purges qui, par extension de la répression, vont toucher l’ensemble des Isaaq, notables ou pas, urbains ou nomades. Cette mise à l’écart permet, de fait, de remplir les places vides par des alliés plus sûrs : des pasteurs Ogaden à la recherche de pâturages ou des réfugiés transformés en miliciens. Difficile néanmoins d’affirmer que le pouvoir de Barre s’articule exclusivement autour des structures claniques comme peuvent l’affirmer certains spécialistes, tant il est aisé de voir les clans là où on aimerait les voir ! La mise en place de l’État « socialiste » n’impose pas définitivement de nouvelles formes de pouvoir mais se juxtapose à celles déjà existantes, elles s’imbriquent, se complètent et parfois même s’opposent.
Derrière le discours « révolutionnaire réformateur », le pansomalisme est une constante de la politique du régime. Depuis les affrontements entre les armées éthiopienne et somalienne dans l’Ogaden en 1964, la tension n’est pas retombée. Cette région d’Éthiopie est régulièrement confrontée à des révoltes et des attaques armées de la part de musulmans, Somali ou Oromo. Profitant du renversement en 1974 de l’empereur éthiopien Haïlé Selasié – celui que vénèrent les Rastas – par des militaires se réclamant du marxisme-léninisme, les autorités somaliennes plaident la cause des « séparatistes » et soutiennent plus ouvertement les activités des groupes somali en Ogaden. Pour des raisons qu’il serait trop long d’expliquer ici, le nationalisme somali est très lié au nationalisme arabe dont il reprend la thèse de l’arabité des Somali. Pour cela, autant que pour se trouver des alliés face à l’Éthiopie, la Somalie rejoint officiellement la Ligue Arabe en 1974 et décrète l’arabe seconde langue officielle dont l’apprentissage est obligatoire. En 1977 les guérilleros somali et oromo, organisés contre le pouvoir central dans un « front de libération », se lancent dans des séries d’attaques contre des intérêts économiques provoquant de violentes ripostes de la part de l’armée éthiopienne et de ses alliés cubains. Estimant sans doute par choix géopolitique qu’il est plus judicieux de soutenir l’Éthiopie nouvellement « révolutionnaire », les Soviétiques décident alors de rompre brutalement leur aide à la Somalie. De plus en plus impliquée directement dans les combats, la Somalie déclare officiellement la guerre à l’Éthiopie au début 1978 et décrète la mobilisation générale. Isolée, les actions de contre-offensive des militaires éthiopiens et de leurs alliés lui sont fatales. C’est la débâcle de l’armée somalienne et de ses « protégés » de l’Ogaden, mais aussi la mise en place de camps de réfugiés pour les nombreux Somali fuyant les zones de combats ou la répression éthiopienne. En ce qui concerne le Territoire français des Afars et des Issas, la politique de la République démocratique de Somalie est de soutenir les quelques groupes armés somali opposés aux autorités coloniales françaises ainsi qu’à un projet d’indépendance du territoire. Mais le débat majoritaire tourne toujours autour de la représentativité, et donc de la répartition des bénéfices, entre organisations politiques somali Issa et afar : le nationalisme somali reste marginal. Après un référendum et des tractations politiques, la colonie française laisse place à la République de Djibouti, proclamée en juin 1977. Un accord de « protection » lie dorénavant Djibouti à la France, qui en a fait une de ses principales bases militaires en Afrique. Dans la continuité des liens qui les unissaient auparavant, le nouvel État entretient de bonnes relations – commerciales – avec l’Éthiopie, bien plus qu’avec son voisin dont les orientations politiques sont critiquées et regardées avec méfiance. Quant à la région somali du Kenya, la pacification violente et la déstructuration des modes de vie ont fait taire momentanément les contestations, même si, sporadiquement des affrontements opposent encore des pasteurs aux autorités ou de petits groupes armés aux militaires. L’échec du pansomalisme n’est pas seulement celui d’un régime somalien dont l’unification de tous les Somali est au centre de son discours. Les exemples de Djibouti et de l’Ogaden montrent que les « solidarités nationalistes » ne sont pas automatiques et que les intérêts en jeu dépassent l’appartenance à un hypothétique peuple somali, lorsque des Issa préfèrent l’indépendance avec des Afar, ou que des clans de l’Ogaden se divisent et s’affrontent sur les soutiens à apporter. Les contestations, les rancœurs et les désillusions, mais aussi les dégâts, les morts et les déplacés de cette guerre contre l’Éthiopie cristallisent et radicalisent les critiques et les oppositions au pouvoir en place.
Réfugiés & déplacés
La situation géographique de la Corne de l’Afrique en fait une région où les moussons sont plus irrégulières qu’en Asie, et donc propice à des périodes de sécheresse variables. Suivant que les pluies sont plus ou moins tardives, les conséquences peuvent être dramatiques pour des pasteurs nomades habitués à gérer « au mieux » les équilibres fragiles nécessaires à leur mode de vie. Les multiples sécheresses – une vingtaine – qui ont jalonné les XIXe et XXe siècle n’ont pas été plus nombreuses, ni plus longues que les précédentes, mais l’économie marchande a déstructuré le mode de régulation traditionnel qui n’a pu y répondre. Pas plus qu’il n’a su répondre à l’imposition de frontières convoitées qui coupent les aires de nomadisme. Des camps de réfugiés sont régulièrement mis en place lors des plus grosses sécheresses, puis souvent démantelés. Les camps de réfugiés créés à la suite de la « guerre des shiftas » au Kenya sont progressivement fermés. À la sécheresse de 1973, qui dure deux ans, et cause la mort de 17 000 personnes, l’exode d’un dixième de la population et la disparition d’un tiers du cheptel, la guerre de l’Ogaden ajoute son lot de morts ou de déplacés vers les villes ou les camps de réfugiés durant toutes les années 80. Chaque nouvelle sécheresse (1979, 1981, 1983, 1984-85 et 1987) fait grossir le nombre de réfugiés et de déplacés. Les premiers sont cantonnés dans des camps permanents répartis sur tout le territoire et les seconds sont installés de force dans des régions fertiles afin qu’ils deviennent agriculteurs ou pêcheurs ! Les autorités déplacent ainsi, vers le sud près du fleuve Jubba, 30 000 nomades victimes de la sécheresse de 1974 dans le nord et 100 000 venus de l’Ogaden en 1977, puis 20 000 autres sur la côte de Brava. Prétextes humanitaires pour finaliser des politiques de collectivisation et de redistribution des terres. En 1976, un programme de sédentarisation forcée de 200 000 éleveurs nomades – qui dans le langage officiel ont un mode de production archaïque – est lancé avec l’aide d’organisations internationales et non gouvernementales (ONG), mais dans les années 80 le pouvoir somalien est dépassé par l’exode rural. Des camps de réfugiés s’installent dans Mogadiscio. Le nombre de réfugiés en Somalie se situe entre 700 000 et un million, répartis dans 33 camps en 1980, plus de 40 en 1988. À ce chiffre, viennent s’ajouter les Bantou expulsés des zones de construction des barrages sur le Jubba et le Shabele. Comme toujours, le nombre de réfugiés n’est pas seulement un enjeu humanitaire, il est aussi une manière d’obtenir plus ou moins d’aide internationale – de l’argent et des denrées – ce que les dirigeants somaliens comprennent alors très bien. Entre 1980 et 1985, la Somalie importe les deux tiers de sa nourriture, dont la moitié provient de l’aide alimentaire qui, d’années en années, ne cesse d’augmenter. Les réfugiés somali viennent grossir les camps périphériques et les bidonvilles de Hargeisa, Baïdoa et Mogadiscio. En dix ans, la population de Hargeisa a quadruplé, celle de Baïdoa doublé et à Mogadiscio les réfugiés représentent plus de 15 % des habitants. À titre de comparaison, la troisième plus grosse agglomération en terme démographique, après Mogadiscio et Hargeisa, est composée des quatre camps de Jalalaqsi au Kenya peuplés de 85 000 personnes. Parmi ce flot de Somali, quelques Oromo se faufilent et s’installent dans le nord et à Djibouti. Les arrivées de tous ces réfugiés contrastent avec les nombreux départs pour l’étranger de Somali contournant la loi de 1976 qui impose des visas de sortie pour les moins de 40 ans et fuyant la répression du régime en place ou la situation économique. D’après les estimations, entre 1981 et 1989, Mogadiscio voit sa population passer de 500 000 à 2 millions d’habitants. Le déséquilibre économique et démographique pèse sur la ville et son arrière-pays qui consomment la moitié des importations céréalières alors qu’ils ne représentent qu’un quart de la population totale. Les répercussions touchent l’ensemble du pays. Les internationaux des ONG et des Nations Unies s’installent dans les quartiers riches de la ville où ils ne manquent de rien, bénéficiant des largesses du système et des trafics grâce à l’argent de l’aide internationale.
Libéralisme somalien ?
En 1974, l’industrie n’emploie que 12 000 personnes réparties dans un peu plus de 200 établissements, dont plus de 7000 dans des entreprises de plus de cinq salariés. Il n’existe que 22 entreprises d’État mais elles monopolisent environ 60 % des emplois. Les principales industries sont la sucrerie de Jowhar, les conserveries de viande de Mogadiscio et Kismayo, les conserveries de thons et de maquereaux. Les autres industries sont des usines de textiles, de boissons, de fabrication de pâtes, de plastiques, de tomates, de jus de fruits, de parfums, une distillerie de rhum et une laiterie. Quelques-unes datent de la colonisation italienne. Une partie de la production est subventionnée par l’État et certains produits tels le sucre, la farine et l’huile sont rationnés. Les prospections minières et pétrolifères ne donnent pas grand-chose. Les quelques sources de minerai (fer, uranium et cuivre par exemple) sont maigres et les différentes tentatives des entreprises pétrolières américaines, britanniques ou françaises de trouver des gisements terrestres ou offshores dans le nord-est restent sans lendemain. De manière générale, le très faible réseau routier bitumé (1400 kilomètres) et l’inexistence de voies ferrées ne facilitent pas les projets et le transport des marchandises d’exportation destinées à l’Europe de l’Est et de l’Ouest – selon les découpages géopolitiques de cette période.
Après la rupture diplomatique entre l’Union soviétique et la République démocratique de Somalie, cette dernière se tourne vers le « bloc de l’Ouest » et se rapproche des États-Unis d’Amérique. Un accord de coopération militaire est signé entre les deux pays en août 1980 par lequel les États-Unis récupèrent l’ancienne base soviétique de Berbera. Premier pays donateur, premier partenaire commercial et principal acteur dans la construction d’infrastructures depuis l’indépendance, l’Italie, ses politiciens et ses financiers, font un retour dans le pays. Mais aussi l’Afrique du Sud raciste de l’Apartheid avec qui le pouvoir somalien entretient de bonnes relations, malgré les fortes critiques des pays africains ou arabes. Pour autant, la Somalie continue d’entretenir des relations distantes avec son ancien allié, ce qui reste suspect aux yeux des Américains. La plupart des pays occidentaux observent à distance « raisonnable » le jeu politique somalien, sans s’impliquer réellement, à l’exception de l’Italie. Qui dit alliance politique avec ces nouveaux amis, sous-entend ajustements économiques : face au coût énorme de la guerre dans l’Ogaden, à l’afflux de réfugiés et à l’échec des politiques économiques, les autorités s’engagent auprès du Fonds Monétaire International (FMI) et de bailleurs de fonds internationaux à restructurer l’appareil d’État et le système économique afin de les rendre plus rentables. La dette extérieure passe de un milliard de dollars en 1980 à presque deux en 1987. La Banque mondiale propose « d’ajuster la taille des troupeaux », ce qui en terme clair signifie développer les grands élevages – au détriment des troupeaux traditionnels – et intensifier l’agriculture dédiée à l’exportation. En 1982, la production de bétail représente 93,3 % des exportations et les produits agricoles seulement 1,3 %. Officiellement pour des raisons sanitaires, l’Arabie saoudite décide en 1983 de stopper ses importations de bétail somalien. Ce désistement du principal importateur – plus de 80 % des recettes du commerce extérieur somalien – est un coup dur pour les pasteurs et la filière d’exportation traditionnelle, une forme d’injonction à réformer rapidement la production de bétail. Cette mesure saoudienne touche principalement la région de l’ex-Somaliland dont l’économie est basée sur l’exportation de bovins, d’ovins et de camelins à destination du Moyen-Orient et de l’Arabie saoudite. Les commerçants Majerteen aussi en souffrent, eux qui en contrepartie de leur évincement du pouvoir en 1969 et de leur maintien à l’écart de la vie politique, ont obtenu le monopole d’État du commerce de bétail dans le nord. Durant les années 80, les quelques réformes sociales et économiques instaurées depuis 1969 s’en trouvent remises en cause. Le budget alloué à l’éducation ne permet plus de payer suffisamment les professeurs et d’entretenir les structures : le taux de scolarisation est de 70 % à Mogadiscio et de 10 % dans les campagnes. Entre 1982 et 1990, un quart des écoles primaires ferment, seules les écoles coraniques – depuis ouvertes aux filles – parviennent à se maintenir. Alors que l’élevage stagne, la forte demande de produits agricoles et l’inflation née de l’abandon du contrôle des prix sur les récoltes font de la terre un bon investissement pour les notables. Et une spoliation de plus pour les paysans qui y travaillent. Le prix de l’hectare irrigué est multiplié par 30 ! Les cultures industrielles alimentent les nouvelles usines de transformation de sucre, de coton et de viande mises en place quelques années auparavant, et dont la production est destinée à l’export. Avec cette libéralisation, les entreprises du secteur privé se développent. Ces réformes économiques et les opportunités d’investissement qu’elles offrent à ceux qui ont le regard bienveillant des autorités somaliennes et de l’argent font émerger une « classe » de nouveaux riches, essentiellement urbains.
Contestations populaires & oppositions politiques
Au lendemain de la débâcle somalienne, des militaires vont exprimer leur mécontentement sur la gestion de la guerre et le retrait des troupes. Une première tentative de coup d’État est déjouée en avril 1978 et 17 officiers sont exécutés. S’ensuivent des purges parmi les politiciens et les militaires et des changements dans les alliances, mais le pouvoir en place est suffisamment solide pour résister aux pressions internes. La fin de la guerre contre l’Éthiopie en Ogaden est une date qui marque un tournant dans la situation somalienne. L’afflux de réfugiés, les déséquilibres économiques et politiques entre le nord et le sud, la situation économique et les critiques contre le régime, les violences policières et la répression vont être les ingrédients d’un cocktail explosif qui, doucement, va ébranler l’État somalien. Ce sont les contestations populaires et l’action d’une multitude de partis politiques et groupes armés qui lui porteront le coup de grâce.
Depuis 1969, l’ex-Somaliland – habité majoritairement par des Isaaq et quelques clans Darod et Dir – reste à l’écart des retombées économiques directes et du pouvoir politique. Le nombre croissant de réfugiés d’Ogaden avec qui ils se retrouvent en compétition pour les espaces de pâturages autour des camps – dans une région où 80 % de l’économie repose sur l’élevage – ou qui s’entassent dans les périphéries des villes crée des tensions entre les Isaaq et ces réfugiés. L’aide alimentaire internationale, distribuée depuis Mogadiscio, peine à arriver jusque dans le nord, si ce n’est à coup de bakchich ou de marché noir. Entre 1985 et 1990, seulement 7 % de l’aide financière internationale est redistribuée dans cette région qui contient un tiers des habitants. L’armée et ses milices alliées, très présentes dans les villes, font régner l’ordre et se servent largement de leur pouvoir pour s’enrichir ou compenser les mauvaises paies. Le commandement de la zone militaire de Hargeisa et Burao remplit les prisons d’opposants politiques et de Somali coupables d’avoir enfreint la loi pour survivre. Que ce soit au prétexte de la lutte anti-clanique ou contre les opposants politiques, les autorités militaires mènent une politique qui exclut les Isaaq : les terres ou les locaux confisqués sont attribués à des non-Isaaq, des obstacles administratifs et l’obligation d’avoir recours à un intermédiaire non-Isaaq pour une licence de commerce, etc. Les caisses publiques sont vides et la situation sociale est tendue. Fin 1981, des intellectuels et des fonctionnaires d’Hargeisa lancent une souscription populaire pour entreprendre la rénovation, autofinancée et autogérée, de l’hôpital de la ville. Ils sont arrêtés et passent en procès le 20 février de l’année suivante. Ce jour-là, la manifestation de soutien des étudiants tourne à l’émeute, qui s’étend à Burao. Après trois jours d’affrontements, cinq morts sont relevés et plus de 200 personnes arrêtées. En 1982 et 1983, à la date anniversaire, de violentes manifestations opposent les contestataires et les forces de l’ordre. Pour échapper à la répression, une partie des étudiants entrent dans la clandestinité mais ils sont arrêtés en juillet 1984 ; la soit-disant « direction clandestine » est démantelée. Ils sont condamnés en octobre à des peines capitales pour sept d’entre eux et de lourdes peines pour treize autres. Un mois plus tard, trois personnes – dont deux enseignants – détournent un avion commercial vers l’Éthiopie pour demander la libération des étudiants. Sans succès. En parallèle de ce mouvement, et sans lien direct avec lui, le Mouvement National Somali (MNS) est créé en 1981 par des expatriés à Londres et dont le programme principal est une critique de l’hégémonie politique et économique du sud sur le nord. Composé principalement de notables, d’intellectuels et de militaires Isaaq, ce nouveau parti politique, dont la direction est alternativement donnée à l’un des sous-clans Isaaq, s’ouvre à des membres des clans Dir Gadabursi, Darod Dulbahante et Hawiye. Il se dote d’une branche militaire dont les bases sont en Éthiopie, qui le finance en partie. Le débat entre être une organisation pan-Isaaq ou un mouvement national, comme l’indique son intitulé, est récurrent. Entre 1983 et 1984, le MNS lance de nombreuses attaques contre les forces gouvernementales : 800 prisonniers sont libérés lors de l’attaque de la prison de Berbera et les affrontements avec l’armée se multiplient dans les zones montagneuses. D’abord assez isolé, il bénéficie de plus en plus de la sympathie de jeunes étudiants et de militaires Isaaq qui, depuis 1984, désertent en nombre pour ne pas participer à la répression. Avant la tentative de dialogue via les aînés en 1985, les deux années d’état d’urgence sous l’œil de Mohamed Siad Hersi « Morgan » – gendre de Siad Barre – nommé responsable militaire de la région, sont faites de couvre-feu, d’arrestations arbitraires, de fouilles nocturnes, de tortures et de viols dans les villes de l’ex-Somaliland. Pendant cette période, de nombreux Isaaq fuient vers des camps de réfugiés en Éthiopie voisine. L’assassinat en 1986 du chef de la police politique remet au goût du jour l’état d’urgence à Hargeisa et Burao. Les nomades, jusqu’ici épargnés, se retrouvent au centre des attentions : le MNS voit en eux des alliés naturels et l’armée de supposés appuis aux guérilleros. À partir de 1984, toutes les actions du MNS sont suivies de représailles violentes contre les civils accusés de les soutenir. De plus en plus de nomades subissent les exactions de l’armée qui pille le bétail, détruit les points d’eau à l’explosif, tue les récalcitrants et parfois pose des mines antipersonnel. Dans l’impossibilité de continuer à nomadiser, ils rejoignent les rangs du MNS ou passent la frontière avec l’Éthiopie pour s’installer dans des camps de réfugiés. Entre 1982 et 1988, aucune des actions militaires du MNS n’est décisive. Il est une guérilla principalement rurale qui attaque des garnisons isolées et coupe les voies de communication terrestres. L’hostilité contre le gouvernement et le soutien au MNS sont croissants dans le pays Isaaq et sa communauté expatriée au Yémen. Les équilibres entre Isaaq et les autres clans au sein du MNS sont fragiles et le pouvoir tente d’organiser des milices supplétives de Dulbahante et de Gadabursi, mais aussi de réfugiés Ogaden. Venu célébrer à Hargeisa le nouvel accord de paix de 1988 avec l’Éthiopie, et donc l’arrêt du soutien de ce pays au MNS, Siad Barre est copieusement sifflé et accueilli par des jets de pierres. Lâchés par leur principal allié, environ 800 combattants venus du territoire éthiopien attaquent Burao en mai. Les combats durent des semaines. La contre-offensive est terrible. Pendant l’été, afin de déloger les membres du MNS et démanteler ses réseaux de soutien, environ 70 % des villes d’Hargeisa et de Burao sont détruites par des bombardements aériens et des tirs d’artillerie. Le bilan est de 40 000 morts. Les exécutions sommaires et les destructions poussent 400 000 Isaaq, principalement des citadins, à fuir massivement vers l’Éthiopie, 40 000 vers Djibouti et autant dispersés dans les montagnes de l’arrière-pays et le sud de la Somalie. Une partie des réfugiés de l’Ogaden installés dans ces villes investissent les ruines, et certains participent à une milice qui en chasse les quelques Isaaq restés sur place. Ces bombardements assoient la légitimité du MNS vis-à-vis des Isaaq. La contre-offensive du MNS met à mal ce qu’il reste de l’armée régulière et des dernières poches de résistance des milices de Gadabursi, de Dulbahante et d’Ogaden.
Créé par un des militaires putschistes de 1978 et soutenu par les Éthiopiens, le Front Somali du Salut (FSS) est le premier mouvement politique à prôner le renversement du régime de Mogadiscio. Présent parmi les pasteurs du lignage Umar Mahamud des Majerteen, le FSS s’affronte durement avec les militaires somaliens en 1981 et 1982 dans le centre du pays. Il s’allie au début des années 80 avec de petits groupes marxistes – opposés au ralliement de la Somalie aux États-Unis – pour former le Front Démocratique du Salut Somali (FDSS). Actif dans la région du Mudug, le FDSS y affronte la répression. Finalement, les différentes tentatives d’alliances avec le MNS se soldent par des échecs, comme celles avec les groupes marxistes. Malgré l’arrêt du soutien éthiopien en 1988 et la politique de destruction des puits par l’armée somalienne, le FDSS étend son autorité vers l’extrême nord-est de la Corne, dans tout le pays Majerteen.
Dans le sud du pays aussi, les combats se multiplient. Le Congrès Somali Unifié (CSU) est le dernier né des mouvements d’opposition, fondé en 1989 à Rome (Italie) par des Hawiye critiques de l’hégémonie des Isaaq au sein du MNS. Il est actif à la frontière avec l’Éthiopie, puis dans le Mudug avant de se diriger vers Mogadiscio pendant l’été 1990. Le CSU s’allie au Mouvement Démocratique Somali (MDS), représentant les clans Rahanweyn et leurs anciens « serfs » bantou, lors de combats contre l’armée somalienne dans la mésopotamie. Ces deux mouvements s’affrontent aussi souvent aux milices Marehan et Ogaden toujours fidèles au pouvoir.
Au vu de la situation dans le pays, tous ces sigles laissent songeurs quant à la sincérité du message politique. Tous sont pour une Somalie unie ! Néanmoins, il ne faut pas caricaturer. Car si la plupart des groupes armés ou des milices sont de plus en plus mono-claniques – parfois des sous-clans – il n’en reste pas moins que les alliances et les trahisons se font sur des considérations politiques et économiques. Pour cela chaque sous-clan d’un même clan se divise et s’oppose, et fait des alliances avec des sous-clans issus de clans différents du sien. Traditionnellement, en cas de conflit, la structure clanique rassemble les sous-clans d’un clan contre ceux d’un autre clan dans une solidarité mécanique. Dans le jeu politique présent, c’est l’inverse. Malgré cela, aucune décision n’est prise sans consultation préalable des conseils d’aînés ou de notables. Leurs avis ne sont pas pour autant toujours écoutés par les mouvements armés et les milices. Ils ne sont plus que consultatifs et pas nécessaires pour obtenir une quelconque légitimité. Inversement, des discussions entre différents conseils d’aînés ont parfois permis d’apaiser des tensions entre des clans ou des lignages, lorsque le niveau de tension est encore faible, ou d’être à l’initiative de tentatives de pacification entre factions combattantes.
Le pouvoir de l’État dispose pour sa part d’une armée de 60 000 hommes et de plus de 30 000 miliciens paramilitaires sur l’ensemble du territoire. Mais l’armée est profondément divisée depuis la débâcle de l’Ogaden et le commandement central peine de plus en plus à faire entendre et appliquer ses ordres. Dans diverses régions, des groupes de paramilitaires s’autonomisent progressivement et vivent sur le dos des populations locales pour compenser l’absence de salaire de l’État et faire « régner l’ordre ». Dès la fin des années 80, l’armée somalienne est déjà largement affaiblie et n’est plus présente sur tout le territoire. Les forces militaires et paramilitaires ne peuvent résister que de manière dispersée et très mal coordonnée, autour des centres du pouvoir ou dans leurs régions de cantonnement.
Contre le khat ?
Les autorités coloniales britanniques ont tenté d’interdire en 1921 et 1939 la vente et la consommation du khat, sans succès. En janvier 1957, elles décident de lever l’interdiction et d’imposer une taxe à l’importation du khat venant d’Éthiopie et du Kenya. Avant 1960, la consommation se limite essentiellement au Somaliland, parmi les Isaaq, alimentés par la production dans la région éthiopienne de Harar. Le khat est répandu dans la région, principalement dans les villes. De petits groupes de poètes défendent son usage car, selon eux, il alimente une part de leur imagination poétique. Généralement, la séance de khat est quotidienne et collective. Elle est un moment, entre hommes, où se passent de nombreuses discussions autour d’un verre de thé ou de lait de chamelle. Seules les vieilles femmes sont autorisées à brouter dans l’espace public, les autres doivent se contenter de le faire dans la sphère privée, en famille. En 1982, 57 millions de dollars sont dépensés par les Somaliens pour l’achat quotidien d’une ou deux bottes de feuilles de khat. Environ 4000 tonnes sont importées annuellement. La commerce, jusqu’alors florissant pour les commerçants Isaaq du lignage Saad Musa, est interdit en mars 1983. Le discours officiel pour justifier cette interdiction mêle une volonté d’affaiblir le financement du MNS par les commerçants Isaaq, et une propagande sur les méfaits physiques et sociaux d’un usage régulier. Dans le nord, les plantations sont systématiquement détruites et plus de 5000 familles impliquées dans la culture ne sont pas indemnisées. Une forte amende et plusieurs années de prison sont prévues pour tout contrevenant à la nouvelle loi. Des filières clandestines, venant d’Éthiopie, se réorganisent doucement et les prix augmentent immédiatement. Entre 1983 et 1985 il est difficile de trouver du khat à Mogadiscio, si ce n’est dans les cercles du pouvoir, dont certains bénéficient des retombées du trafic illégal. Comme partout, le discours politique sur les « stupéfiants » dissimule difficilement les envies d’ordre social derrière l’aspect sanitaire. La propagande du régime somalien vise principalement les jeunes urbains, en rupture avec l’ordre traditionnel, et les plus pauvres à qui il est martelé que la consommation de khat les rend responsables de leur situation économique et sociale ! En 1989, plus de 300 tonnes de khat et près de 1000 camions de transport sont saisis. Environ 7500 personnes sont arrêtées lors de cette opération. Finalement, en avril 1990, le régime finissant abolit la loi interdisant le khat, officiellement pour « satisfaire la demande du peuple ». Le marché se réorganise rapidement, une quarantaine de salles de ventes se montent et les plantations se relancent autour d’Hargeisa.
Genres. Urbanisme & modernité
Depuis la guerre de l’Ogaden, des milliers de familles sont devenues monoparentales. Soit l’époux est mort, soit il est en train de combattre ou à la recherche d’un travail en ville ou à l’étranger. De nombreuses familles monoparentales vivent dans les villes. La charge de chef de famille se féminise face aux circonstances. Le taux de scolarisation des filles n’étant que de 3 % – 10 pour les garçons – et leur éducation une charge économique supplémentaire jugée inutile, peu accèdent à une formation permettant de trouver un travail salarié. La politique volontariste du pouvoir, la propagande et les lois ne suffisent pas à amoindrir les discriminations que subissent les femmes. Comme les partis politiques, les associations féminines sont interdites en 1969, remplacées par des associations de jeunesse et autres organismes d’État. Symboliquement, Hawa Osman Tako, morte en 1948 sous les coups italiens, est promue figure historique et nationale de la cause des Somali, aux côtés de Mohamed Abdille Hassan, le chef de la révolte des Derviches contre les Britanniques, et du soldat inconnu ! Une statue lui est érigée en 1972 à Mogadiscio, face au bâtiment du mouvement de jeunesse féminin d’État. Les campagnes contre l’excision/infibulation et pour convaincre la population de ne plus rejeter les femmes non-excisées restent quasiment sans effet. Les plus riches le font faire « proprement » par des médecins. À Mogadiscio, quelques familles refusant l’excision de leurs filles se regroupent dans un quartier de la ville pour mieux se protéger. Elles établissent un réseau de solidarité afin que tous les habitants de ce quartier – hommes et femmes – protègent ces jeunes filles non excisées et non infibulées lorsqu’elles sortent de leur domicile. Ces familles se heurtent quotidiennement à l’hostilité violente de celles et ceux favorables aux mutilations traditionnelles et aux attaques de la police. Beaucoup sont assassinées ou emprisonnées. Les lois de 1975 qui abolissent la polygynie et donnent les mêmes droits en matière d’héritage ne sont pas très suivies. La réforme du mariage et l’obligation de le faire en mairie prive même une partie d’entre elles de leur dot, qui est un peu leur assurance-vie. Les quelques emplois pourvus par des femmes ne résistent pas à la crise économique et sa valse des réductions d’effectifs et de salaires. En 1983 à Mogadiscio, près de 40 % des habitantes entre 15 et 19 ans sont nées dans la capitale. L’enracinement des femmes dans le milieu urbain, en les éloignant d’un environnement traditionnel, fait baisser le nombre de mariages forcés. La situation économique de cette époque permet moins la pratique du lévirat, ce qui laisse de nombreuses veuves isolées. Ce mélange entre exode et urbanité, situation économique et appauvrissement, va accroître les responsabilités et les possibilités de ces urbaines. Mais il n’y a pas que des foyers monoparentaux, dans certains, les hommes sont présents, mais le chômage ou leurs refus des travaux jugés indignes font que la responsabilité repose sur les femmes, promues cheffes de famille. Tous les petits travaux habituellement réservés aux femmes sont des moyens de subsistance. Le ramassage du bois, la collecte de l’eau, le glanage ou le petit commerce deviennent des activités essentielles à la survie des familles. À cela s’ajoutent les produits de petits jardins qui complètent les ressources du foyer. L’exode rural produisant des regroupements par clans dans les quartiers de la capitale, les formes de solidarité et d’entraide entre les femmes s’adaptent. Ainsi, le système de solidarité financière organisé collectivement par un petit groupe de femmes du même voisinage et de la même tranche d’âge, sans parenté commune, se transforme en solidarité entre des femmes du même clan et de tous les âges. Évidemment, en ville, les projets sont autres et nécessitent plus d’argent. Progressivement, le petit commerce de détail et les échanges deviennent à Mogadiscio des activités tenues essentiellement par des femmes.
À la fin des années 80, 76 % de la main-d’œuvre travaillent dans l’agriculture et plus de 86 % sont des femmes. Elle s’occupent de l’agriculture vivrière et du petit bétail, à l’exception des chameaux restés sous la « protection » des hommes. Les veuves ou les femmes seules, en plus de s’occuper du foyer, gèrent les troupeaux qui sont une richesse que l’on n’abandonne pas. Mais leur situation reste précaire car, contrairement aux lois de 1975 ou à la loi coranique, en cas de décès du chef de famille les lois coutumières peuvent permettre la transmission des terres aux enfants mâles ou leur gestion par la famille s’ils sont encore trop jeunes. La campagne d’enregistrement des terres, faite quelques années auparavant, montre que seuls 7 % appartiennent à des femmes ; chiffres sans doute gonflés par les hommes qui ont fait enregistrer les terres au nom de leurs filles ou de leurs femmes afin de cacher une partie de leur richesse. De fait, certaines veuves peinent à récupérer les terres enregistrées au nom du mari défunt. Les formes de ségrégation spatiale sont toujours bien plus présentes dans les milieux ruraux ou nomades que dans les villes et leurs périphéries proches. La pression sur la tenue vestimentaire des femmes n’est pas une constante et le port du voile islamique n’est pas une règle dominante, même dans les milieux ruraux ou pastoraux plus conservateurs. Tout comme en ville, le système d’entraide et de solidarité financière entre femmes restent un moyen d’améliorer le quotidien et de créer des liens sociaux. De part leur rôle majeur dans la survie économique des foyers, les femmes sont en première ligne pour réclamer aux autorités tout ce dont elles manquent – nourriture et soins. À Mogadiscio, les manifestations de femmes sont fréquentes et les heurts parfois meurtriers. Leurs contestations sociales sont une critique directe et une réponse à la politique du régime mais aussi la démonstration d’une autonomie gagnée au sein de la société somali.
Jeunes urbain.e.s & bandes de jeunes
L’urbanisation rapide de la Somalie – de 17 à 36 % de la population entre 1960 et 1990 – a engendré une nouvelle situation pour les jeunes Somali. Contrairement à ceux ne vivant pas en milieu urbain, ils sont moins contraints par l’éducation traditionnelle et sont le produit de l’école publique. Mais pas seulement, heureusement ! Entre 1972 et 1973, des milliers de jeunes ayant fini leur cycle d’études bénéficient d’une formation accélérée. Dans le cadre d’une campagne d’alphabétisation, nombre d’entre eux sont nommés instituteurs. Surnommés caasi (insoumis), ils sont une autorité en compétition avec celle des anciens qui jusqu’alors dispensaient l’éducation. Même si grâce à leur salaire, ils sont plus riches que les jeunes ruraux, ils vivent néanmoins dans les quartiers pauvres des grandes villes somaliennes. Ces urbains, pauvres et jeunes, cultivent leurs différences par leurs tenues vestimentaires, leurs goûts musicaux – reggae, musique somalienne moderne, jazz – et leur consommation de produits divers, créant une sorte de sous-culture moderne et urbaine.
L’afflux de réfugiés de la guerre de l’Ogaden et la crise économique que connaît le pays vont un peu plus appauvrir les urbains. Parmi les mesures du FMI, le licenciement et les économies sur les budgets mettent beaucoup de fonctionnaires au chômage et les contraignent à multiplier les petits boulots. Qu’ils soient chômeurs ou pas, vivant de petits travaux ou de trafics, les jeunes des quartiers populaires se débrouillent pour survivre. Les orphelins et les familles monoparentales, dont le père est mort lors de combats ou à la recherche d’un emploi à l’étranger, sont une part importante de la population pauvre. Une partie des enfants survit en étant cireur ou ramasseur de bois, par exemple, alors que des femmes se mettent à revendre les denrées issues des trafics ou des vols. Les quartiers populaires sont insalubres, sans services sanitaires et médicaux, et avec de gros problèmes d’approvisionnement en énergie ou en nourriture. Les bidonvilles de réfugiés s’agrandissent. Le taux de chômage explose et une partie de la population vit de l’entraide ou de la charité des associations islamiques ou humanitaires. Certains jeunes s’installent dans des maisons squattées dans lesquelles ils vivent en groupe : garçons et filles, entre quatorze et vingt ans, se côtoient dans le quotidien, partagent ce qu’ils ont détroussé ou acheté et se défendent face aux agressions « extérieures ». D’autres sont simplement du même quartier et, parfois, s’organisent ensemble pour mener des vols ou des petits trafics, sans pour autant former une bande « fixe ». Même si la plupart des quartiers se répartissent selon les clans, beaucoup de ces regroupements de jeunes se font aussi sur des critères d’affinités ou de proximités géographiques. Ces bandes sont appelées mooryaan à Mogadiscio, jirri à Kismayo et Bassasso, day-day à Hargeisa ou dhafoor-qiiq dans les villes du nord-est. Ces termes sont généralement dépréciatifs mais parfois réappropriés par les jeunes eux-mêmes. Par la débrouille, les trafics, la violence et les transgressions qu’elles représentent, ces bandes deviennent un repoussoir social facile que les élites traditionnelles ou le pouvoir accusent de tous les maux. Dans le début des années 80, la population de Mogadiscio est hétérogène. Le clan Habar Gedir des Hawiye est très présent dans la capitale. Les mooryaan de Mogadiscio se composent de jeunes urbains – souvent Hawiye – et de nouveaux arrivants issus de différents sous-clans Habar Gedir et plus généralement de clans Hawiye du centre du pays ou d’immigrés Isaaq du nord. Les combats de 1987 et les exactions des milices poussent encore d’autres jeunes Hawiye à rejoindre Mogadiscio. Munies d’armes légères, les bandes de mooryaan n’hésitent pas à s’affronter avec les militaires dans les quartiers périphériques. Les vols réguliers de véhicules 4X4 officiels, les pillages de convois de ravitaillements et des maisons de notables sont quelques unes des formes de résistance au régime que ces groupes de jeunes pratiquent régulièrement. Selon certains d’entre eux, des actions communes ont été menées avec des étudiants en 1988 pour dénoncer les violences quotidiennes et la situation économique catastrophique.
La répression est féroce et les militaires bombardent parfois des quartiers suspectés d’être des abris. Le pouvoir n’arrive pas à déterminer la composition « clanique » des mooryaan et va jusqu’à assassiner une cinquantaine de Isaaq, en pensant toucher juste. Gros consommateurs de khat, les jeunes de ces bandes sont très démonstratifs de leur singularité et de leur pouvoir. Quel que soit leur sexe, ils aiment arborer les chaînes en or, les boucles d’oreilles et les bagues dans des postures de défiances, où les armes sont omniprésentes. La place des femmes dans ces bandes n’est pas claire car la culture somali valorise l’utilisation de la violence seulement pour les hommes. Malgré cela, des jeunes garçons et filles combattent parfois ensemble lors d’affrontements avec les militaires à la fin des années 80. Qu’elles soient permanentes ou éphémères, ces bandes de jeunes entretiennent des rapports distants, de défiance, avec l’autorité des aînés et de leurs familles ou clans. La discussion sur leurs méthodes et modes de vie n’est pas envisageable car une telle remise en cause par des aînés, par exemple, ruinerait à coup sûr tout reste de légitimité de ces derniers. Le degré de violence qu’elles exercent ou les bénéfices qu’elles peuvent apporter à leur entourage font qu’elles deviennent des interlocutrices possibles pour des questions militaires et stratégiques ou un mal « acceptable » pour la population qui les subit partiellement. Il arrive que le phénomène des bandes urbaines en Somalie soit rapproché d’autres formes de banditisme régional comme les shiftas, ces bandits qui défiaient le pouvoir central en Éthiopie. Mais il semble que les structures des bandes shiftas soient plus centralisées et autocratiques que celles de ces bandes modernes dont les « leaders » ont un pouvoir relatif et, souvent, éphémère. Le rapprochement peut être fait aussi avec les barcad (« massues blanches »), des bandits de grands chemins qui sévissent dans les campagnes et avec qui les mooryaan partagent la pratique de l’attaque de convois de nourriture, mais aussi avec les pillages ou les razzias dont les nomades somali sont traditionnellement adeptes.
Fin de régime
Dans le nord, le MNS, dont le discours est de plus en plus séparatiste, tente de s’allier les anciennes milices qui depuis se sont transformées en mouvements politiques : L’Alliance Démocratique Somali (ADS) qui regroupe des Gadabursi et des Oromo réfugiés, le Front Somali Uni (FSU) des Issa et le Parti Somali Uni (PSU) des Dulbahante et des Warsangali. Les accrochages sont fréquents entre le MNS et, d’une part, les combattants du PSU qui voient d’un mauvais œil l’idée d’un Somaliland indépendant, d’autre part, ceux de l’ADS et du FSU qui veulent garder le contrôle et les bénéfices qu’ils tirent de la frontière avec Djibouti. Le MNS ferme les yeux sur les représailles contre des populations Dulbahante, Gadabursi et Ogaden, accusées d’avoir soutenu les milices pro-gouvernementales.
Dans Mogadiscio, la révolte populaire gronde. La capitale somalienne est le dernier bastion du régime de Siad Barre, réduit désormais à être simple « maire de Mogadiscio », confronté aux bandes de jeunes armés et aux manifestations populaires. Aucune des guérillas n’est encore présente dans la capitale. L’armée est en déroute et peut même être considérée inexistante dès 1988. Les désertions de militaires Ogaden, Hawiye ou Isaaq au profit des mouvements armés sont fatales pour cette armée jusqu’alors multi-clanique. Elle n’est plus qu’un regroupement épars de milices dominées par des Marehan ou composée d’une multitude de petites troupes mal payées, sans commandement centralisé, qui vivent de pillages sur tout le territoire jusqu’à l’effondrement de l’État. L’année 1989 est parcourue de contestations et d’oppositions au régime. Le 14 juillet, l’arrestation de leaders musulmans se transforme en protestations à travers toute la ville qui se soldent par la mort de plusieurs centaines de personnes, abattues par l’armée. Après plusieurs jours d’affrontements, on compte plus d’un millier de morts. Malgré les remaniements ministériels et les dernières tentatives désespérées de sauver la République démocratique, les combattants du CSU et du Mouvement Patriotique Somali (MPS) – fondé un an plus tôt par des militaires déserteurs Ogaden alliés à des Majerteen et quelques clans Dir et Rahanweyn – progressent dans la mésopotamie et s’apprêtent à prendre la ville de Baïdoa. Dans Mogadiscio, le pouvoir est malmené et la répression s’accélère. Le 6 juillet 1990, Barre est conspué lors d’un match de foot. La garde présidentielle tire dans la foule et tue des dizaines de personnes. Tout le mois de décembre de cette année-là est traversé de révoltes et d’émeutes dans les faubourgs. À chaque fois, l’armée s’affronte violemment aux habitants – hommes et femmes – auto-organisés dans les quartiers pour se défendre, se ravitailler et soigner les blessés. Depuis l’entrée du CSU et ses alliés du MDS dans la capitale en décembre 1990, l’armée bombarde régulièrement les positions des rebelles et détruit certains quartiers, faisant des milliers de morts parmi la population. Les combattants du CSU et les nombreux réfugiés des zones de combats de l’arrière-pays ou de la mésopotamie arrivent en masse dans la ville. Environ 2000 prisonniers sont ainsi libérés par la prise de la prison de Mogadiscio, et pour certains, rejoignent les jeunes insurgés. Alliées aux combattants, des bandes de mooryaan participent activement aux affrontements, qui provoquent énormément de pertes parmi elles, mais aussi dans les rangs des militaires. Dans un discours à la fin du mois de décembre, le chef des services de sécurité dénonce les bandes de « jeunes délinquants » responsables de tous les désordres. Les bombardements et les descentes de militaires se multiplient dans les quartiers. Ce sont ces jeunes « délinquants » et les habitants qui sont en première ligne dans les ultimes combats de la capitale. En janvier 1991, Siad Barre est retranché avec ses derniers fidèles à la Villa Somalia. Les manifestants sont massés devant l’édifice depuis des jours. Nombre de femmes sont là, insultant les soldats et balançant des projectiles. Barre et ses proches parviennent discrètement à s’échapper le 26 : la foule envahit le bâtiment et le pille. C’est la fin de la République démocratique de Somalie. Loin des préoccupations internationales et dans un silence médiatique. Tous les yeux sont alors tournés vers l’intervention militaire contre l’Irak lancée quelques jours plus tôt – le début de la première guerre du Golfe.